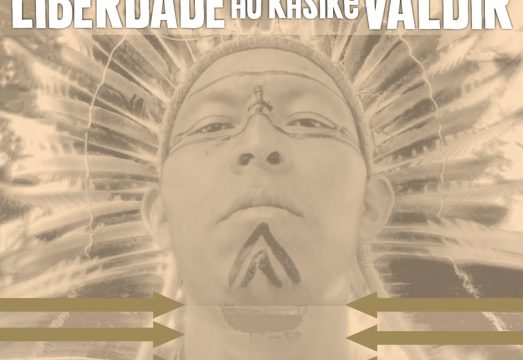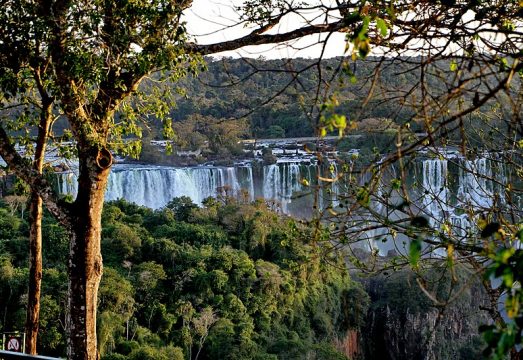Le Brésil : une situation socio-économique complexe
Depuis quelques années, le Brésil se place dans un contexte général complexe. Entre l’augmentation du taux de pauvreté (28,9% de la population en 2021), celle du chômage (14,7% en 2021), la crise économique (pour partie liée à l’inflation), l’affaiblissement du contrôle gouvernemental, la déforestation massive (en avril 2022, près de 1030 km2 de forêt ont été déboisés, c’est 74% de plus qu’en avril 2021) et une approche imminente du point de non retour de l’Amazonie, les voyants sont au rouge.
Un récent rapport de MapBiomass, un collectif formé d’ONG, d’universités et de startups qui collaborent dans le but d’informer sur l’utilisation des territoires brésiliens , de lutter contre les changements climatiques et conserver les terres, fait aussi état d’un autre phénomène inquiétant. Celui-ci n’est pas nouveau, mais il s’intensifie d’années en années. Il s’agit de la hausse des activités minières illégales et de leur empreinte écologique. Celles-ci se produisent sur deux types de territoires brésiliens : à l’intérieur même des territoires indigènes, où elles ont augmenté de 495% entre 2010 et 2020 ; et dans les les unités de conservation, avec une hausse de 301% des activités sur la même période. Ce rapport statue aussi qu’au cours des 30 dernières années, le Brésil a perdu un total de 1,1 million d’hectares de végétation indigène.
Pour être plus précis, certains territoires sont particulièrement concernés par ce phénomène de mines illégales : les 3 territoires indigènes de Kayopó, Munduruku (tous deux dans l’état de Pará) et de Yanomami (entre les états d’Amazonas et de Roraima), qui sont respectivement occupées par des miniers sur des superficies de 7602, 1592 et 414 hectares, soit une surface totale de 10 000 hectares. Et les unités de conservations, dont les plus touchées se situent dans l’État du Pará : la zone de protection de l’environnement de Tapajós, affectée sur 34 740 hectares, la forêt nationale d’Amaná sur 4 150 hectares, et le parc national de Rio Novo sur 1 752 hectares.
Au-delà des espaces atteints, d’autres données chiffrées clés mettent en lumière cette problématique grandissante. D’après un rapport publié en avril 2022 par l’Association indigène Hutukara Yanomami, l’exploitation minière illégale dans la réserve yanomami a presque triplé au cours des trois dernières années et 56% des 27 000 habitants indigènes de la réserve sont directement impactés par celle-ci. Un rapport de 2021 de l’Instituto Socioambiental explique que l’exploitation minière illégale dans la réserve de Munduruku a augmenté de 363 % en l’espace de seulement deux ans.
L’inaction préoccupante du gouvernement brésilien
Depuis 2018, malgré les conflits récurrents entre exploitants miniers et peuples indigènes rapportés au gouvernement brésilien, celui-ci semble ne prendre aucune action correctrice. Trois facteurs contribuent à cette situation. Tout d’abord, la capacité de relocalisation rapide des auteurs de ces crimes, qui les rend difficiles à trouver par les inspecteurs environnementaux. Aussi, la nature de la Constitution brésilienne de 1988. Celle-ci interdit l’exploitation minière dans les territoires indigènes et les unités de conservation, sans pour autant en faire de même pour l’activité de prospection, bien souvent faite sans respect de l’environnement. Le troisième est la direction qu’a prise le gouvernement brésilien ces dernières années. Le Congrès fédéral a en effet la volonté d’adopter un certain nombre de lois autorisant l’exploitation des territoires indigènes. Pour preuve, le 9 mars 2022, un régime d’urgence a été déclaré par la Chambre des députés du Congrès national du Brésil, dans le but d’examiner un projet de loi qui permettrait à terme de légaliser les activités minières sur les terres indigènes en Amazonie brésilienne.
Les causes de cette problématique grandissante…
Mais alors, pourquoi cette prospection concentrée sur les unités de conservations et les territoires indigènes ? Pour une raison majeure : la probabilité de trouver de l’or dans des zones intactes est plus grande que si le sol ou la forêt sont souillés.
Trois facteurs économiques renforcent aussi cette augmentation. La première est l’augmentation depuis 2017 sur le marché international du prix des minerais tels que l’or, l’étain et le manganèse. La seconde, la création d’emploi par cette activité dans un pays marqué par augmentation de la pauvreté et crise économique, et un manque d’alternatives. Enfin, l’absence de moyens de dissuasion juridiques puissants, qui ne va pas dans le sens d’un arrêt de cette activité.
… et les conséquences qu’elle engendre
Or, cette pratique pose un certain nombre de problèmes pour l’environnement, les écosystèmes et les communautés qui vivent à proximité. La destruction du lit des rivières laisse tout d’abord des trous béants qui provoquent l’augmentation de la déforestation et fragilise le sol. La manière dont la prospection est faite, sans permis, en tout cas en Amazonie, et en utilisant du mercure, soulève aussi un problème de santé majeur. Les peuples indigènes qui vivent proche des terres exploitées ingèrent ce minerai par le poisson, à la base de leur régime alimentaire. Ce mercure aurait des effets neurotoxiques pour l’homme, même si aujourd’hui les impacts de ce polluant sont encore fortement méconnus. En termes de santé, les mines clandestines et sans contrôle sanitaire, sont également des vecteurs de transmission du coronavirus dans les villages indigènes. Enfin, en termes d’impacts sociaux, cette activité illégale et le harcèlement des exploitants créés des conflits liés au partage inégal des bénéfices générés et provoque l’augmentation de la prostitution et de la violence causée par l’accès facile aux boissons alcoolisées et autres drogues.
Des pistes de solutions pour lutter contre ces activités minières illégales
Pour restaurer ces milieux, il faudrait les laisser se régénérer seul et sans activité pendant au moins 20 ans, ce qui reste assez peu probable au vu de l’évolution de la situation dans le monde aujourd’hui. Et même après cette période, la qualité des sols et la biodiversité ne seraient pas les mêmes qu’à l’origine. Mais alors, quelles pistes de solutions seraient possibles ? Dans d’autres pays d’Amérique latine, la création de corps, rattachés à une administration publique, qui auraient un véritable pouvoir sur les activités minières illégales, sont en cours d’étude.
Par exemple, en Équateur, pour faire face aux projets écocidaires encouragés par le gouvernement, le 4 février 2022, la Cour constitutionnelle statuait en faveur du droit des peuples indigènes de décider de l’avenir de leurs terres. L’affaire « Sinangoe », lancée en 2018, survenue suite à la présence de concessions minières venues s’installer sur les territoires de ce peuple sans consultation préalable, a permis de donner légalement le droit au peuple Cofán de Sinangoe à un consentement libre, préalable et éclairé et de pouvoir refuser ces projets qui détruisent leurs terres. Le gouvernement équatorien devra dorénavant se plier au règlement et obtenir l’accord des communautés indigènes afin de développer tout nouveau projet.
Sources :
Rapport de MapBiomass : “La superficie occupée par l’exploitation minière au Brésil a plus que 6 fois augmenté entre 1985 et 2020”
Mongabay : “Illegal mining footprint swells nearly 500 % inside Brazil indigenous territories”
À lire aussi sur le site de Planète Amazone :
21 mai 2022 : Mines d’argent en Argentine et au Guatemala : s’unir pour résister
1 mai 2022 : Opération Harpie : une lutte difficile contre l’orpaillage clandestin en Guyane Française
22 mars 2022 : Écocide : les effets du Mercure sur un peuple indigène en Bolivie
18 mars 2022 : Le territoire du cacique Raoni menacé par des projets d’exploration minière
1 mars 2022 : Brésil : Bolsonaro veut développer l’orpaillage en Amazonie
23 février 2022 : Équateur : Une décision juridique historique contre l’exploitation minière !
Article écrit par Léa Zamuner