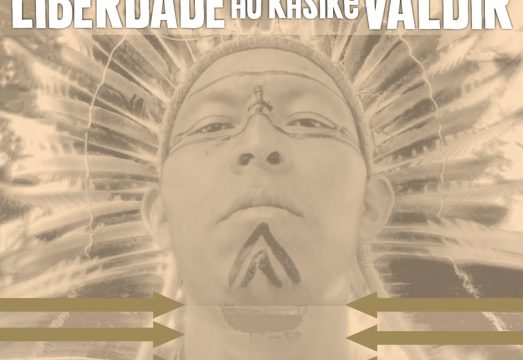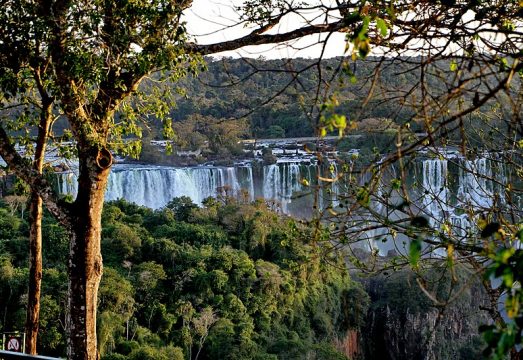Alors que 192 pays sont maintenant impactés par le coronavirus, l’inquiétude est immense en ce qui concerne les populations les plus vulnérables de la planète : les peuples indigènes. Au Brésil, deux indigènes sont déjà décédés des suites du Covid-19. Une femme de l’ethnie Borari âgée de 87 ans à Alter do Chão (municipalité de Santarém), dès le 24 mars et, le 5 avril, un homme de 55 ans, de l’ethnie Mura, a Manaus, capitale de l’Amazonas (Etat comptant le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le nord du pays).
L’histoire de la conquête des Amériques a démontré à quel point ceux que l’on dénomme également peuples premiers ont été décimé par les maladies apportées par les germes des envahisseurs européens, déjà immunisés face à des maladies devenues bénignes sur le vieux continent. Les explorateurs de la deuxième vague furent d’ailleurs étonnés de débarquer dans des endroits quasiment déserts, tandis que leur prédécesseurs leurs avaient décris des lieux à l’activité humaine foisonnante. Normal, certains scientifiques estiment qu’en quelques années, des dizaines de millions d’indigènes étaient déjà morts des maladies transmises lors du premier contact. Et cette histoire terrible s’est poursuivie jusqu’à nos jours.
La vulnérabilité des indigènes face aux maladies étant largement documentée, on tremble donc en temps normal pour les derniers peuples d’Amazonie vivant en isolement volontaire (il en reste très peu), mais aussi pour les autres (toute visite dans leurs territoires est strictement réglementée et conditionnée par une visite médicale préalable). Alors imaginez un peu aujourd’hui ce que ressentent les membres de Planète Amazone et d’ailleurs tous les amis de la cause indigène.
Vous êtes vous demandés comment sont informés et protégés aujourd’hui les quel 305 peuples indigènes du Brésil , qui totalisaient en 2010 (recensement IBGE de 2010) 896 917 personnes, parmi lesquelles 324 834 vivant dans les villes et 572 083 dans les zones rurales (au total, 0,47% de la population totale du pays) ? Très mal évidemment, nous ne pouvions pas en attendre moins de l’administration Bolsonaro.
Petit tour d’horizon pour entrer dans le détail.
Le site Rede Brasil Atual se fait par exemple l’écho d’une mise en garde d’experts de la santé contre le manque de produits d’hygiène dans les communautés et l’extrême difficulté d’accessibilité aux soins en cas d’infection. Mais c’est surtout la réaction du gouvernement face au premier cas de coronavirus confirmé sur une indigène (le 1 er avril) qui a immédiatement soulevé des inquiétudes. Le lendemain, un décret de la Fondation Nationale de l’Indien (Funai) suspend les autorisations d’entrer sur les terres indigènes pendant 30 jours en raison de la pandémie. Le Ministère Public Fédéral, organe juridique compétent pour protéger les peuples indigènes, s’insurge aussitôt, affirmant que cette mesure incomplète et inadaptée, ajoutée à une gestion globalement désastreuse (cf. l’attitude irresponsable du président Bolsonaro), fait courir le risque d’un génocide aux peuples indigènes. Cette mesure d’isolement met en effet en danger toutes les populations autochtones urbaines ou périurbaines, dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leur alimentation sans ravitaillement extérieur. Et comment assurer les besoins sanitaires importants des peuples indigènes dans le cadre de cet isolement ? La FUNAI ne le précise alors pas et fait craindre une aggravation d’un système de santé indigène déjà très fragilisé.
Ana Valéria Araújo, surintendante du Fonds brésilien des droits de l’homme, s’en indigne : « dans le cas [des terres indigènes proches des villes], il y a un besoin d’isolement, mais des politiques doivent être pensées pour garantir l’assistance humanitaire, l’arrivée des vivres et des kits d’hygiène », clame-t-elle.
Une autre inquiétude majeure concerne l’absence de campagne d’information efficace auprès des peuples indigènes, dont une grande proportion ne parle pas portugais (il y a plus de 200 langues autochtones différentes au Brésil), concernant la contagiosité du virus et les attitudes et gestes barrières à produire pour empêcher sa circulation et donc sa propagation. Une ONG, l’Instituto Socioambiental (ISA) a bien lancé une campagne «Restez au village», accompagnée du hastag #FicaNaAldeia, pour sensibiliser les peuples traditionnels, mais quid de ceux qui n’ont pas accès à internet ? Leur plateforme «Covid-19 et les peuples autochtones», lancée le 3 avril, est parfaite pour… le brésilien moyen, mais bien entendu, les messages n’y sont pas traduits dans l’ensemble des langues natives du Brésil. Sur ce point aussi, les carences de l’administration Bolsonaro s’avèrent flagrantes. Le défi est certes compliqué à relever, mais comment ne pas considérer comme particulièrement grave l’absence d’information dont souffre la majorité des habitants des villages indigènes du Brésil, qui occupent près de 14% du territoire national, lorsque l’on sait que cela équivaut tout simplement à une mise en danger ?
Autre point. Interrogé par une parlementaire lors d’une réunion lundi 6 avril, avant même l’annonce de l’intention du président Bolsonaro de démettre le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, le gouvernement s’est avéré incapable de dire si les indigènes pourront bénéficier ou pas d’une campagne de tests Covid-19. Le site Congresso em Foco précise par ailleurs que jusqu’à présent, seuls 6 300 indigènes ont pu être testés. L’indécence de cette administration étant sans limite, on ne s’étonnera pas que certains de ses représentants se soient glorifiés d’avoir augmenté ces jours-ci le nombre de doses de vaccins disponibles pour… la grippe.
Governo não tem data para levar testes de covid-19 aos povos indígenas
Abandonnés par les autorités, les peuples indigènes se retrouvent donc totalement démunis pour affronter, presque totalement seuls, l’une des plus dangereuses crises de leur déjà tragique Histoire. Bien sûr, il faut saluer la proposition faite par cinq parlementaires, dont la seule députée indigène, Joenia Wapichana (Rede-RR), d’un projet de loi instituant une aide d’urgence aux peuples autochtones à hauteur d’un salaire minimum mensuel par famille, mais cela n’est qu’une goutte d’eau face aux besoins réels.
Alors que les critiques se faisaient de plus en plus virulentes, Bolsonaro (dans la tourmente) et son gouvernement ont récemment réagi. Ainsi, la FUNAI a finalement annoncé le 6 avril la mise à disposition d’une somme ridicule de 10 millions de R $ (environ 1,755 million € au taux de change actuel) « pour des actions de lutte contre le coronavirus ». La FUNAI promet d’utiliser ces fonds « pour l’achat d’urgence de nourriture pour les zones d’extrême vulnérabilité sociale, le déplacement d’équipes vers les fronts de protection des peuples autochtones isolés et récemment contactés, ainsi que l’acquisition de véhicules et de bateaux pour faciliter le transport du personnel de santé dans les villages et des autochtones dans les unités de santé. »
Les réactions moqueuses et indignées ne se sont pas faites attendre. Ainsi, le Diario Causa Operaria, a publié un article complet pour dénoncer la mesurette du gouvernement, dont le titre annonce la couleur : « Tandis qu’il offre des milliards à des banques, Bolsonaro donne des miettes à la Funai ». A raison, le média indépendant voit le montant annoncé par la FUNAI comme un acte de mépris envers la population indigène. Le parallèle qu’il propose entre le coronavirus et la grippe espagnole, qui fit, en 1918, plus de mort que les conflits armés de la Première Guerre Mondiale, est particulièrement intéressant : « Dans l’étude de Kyra H.Grantz (2016) sur la grippe espagnole à Chicago, il a été montré que plus il y avait d’analphabètes dans une région donnée, plus le taux de mortalité était élevé (…) de cette façon, il est possible de conclure, à partir des similitudes statistiques de Covid-19 et de la grippe espagnole (…) que les communautés autochtones seront gravement touchées par la maladie. »
Comme le souligne l’auteur, en négligeant de façon aussi évidente la crise sanitaire qui menace les peuples indigènes du Brésil, la FUNAI, organisme censé les protéger, joue le jeu du lobby ruraliste, qui rêve d’enfin pouvoir les anéantir afin de piller leurs territoires. Oui, un taux de mortalité élevé de Covid-19 affaiblirait brutalement la résistance des peuples indigènes qui seraient dès lors et de façon bien plus facile soit assassinés par les forces répressives de l’État et les bras armés des grands propriétaires terriens, soit expulsés de leurs terres par eux.
– par Gert-Peter Bruch –